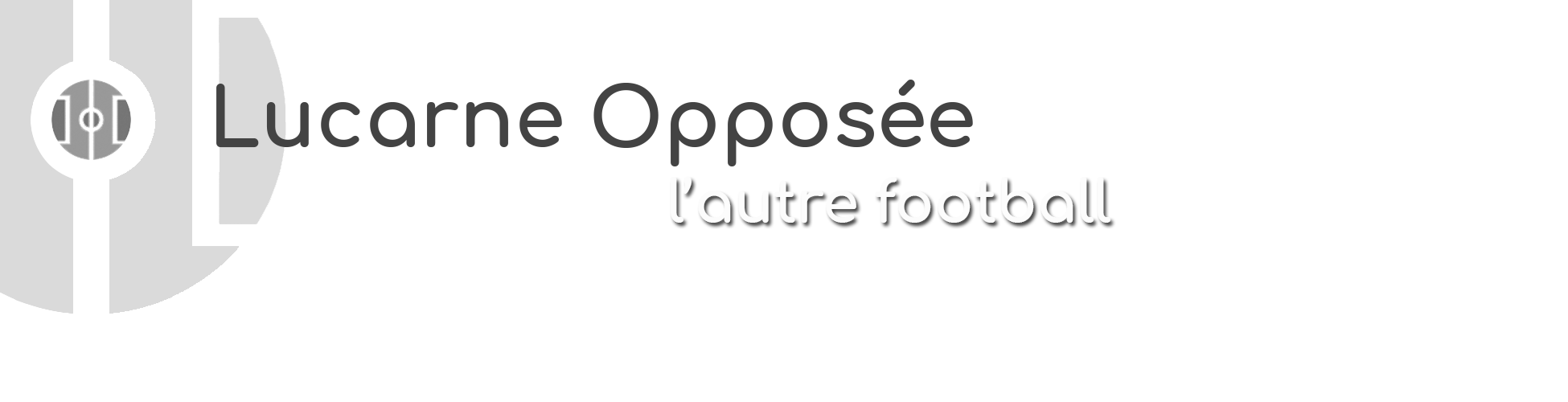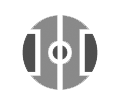La politique est présente dans tous les domaines. Au Moyen-Orient, le football n’y échappe pas et fait partie de stratégies globales. Le sport est incorporé dans les directives des différents régimes souvent comme un outil d’influence ou de contrainte dans une région aux conflits multiples.
Ce jeudi 23 mars, l’Irak va « recevoir » l’Australie dans le cadre des qualifications asiatiques à la Coupe du Monde 2018. L’information a été confirmée, le match se jouera à Téhéran puisqu’en effet, l’Irak ne peut accueillir des matchs sur son sol. Tout comme la Syrie, les équipes doivent trouver des solutions chez leurs voisins plus ou moins lointains.
Rappels historiques
En 1916, le traité « secret » Sykes-Picot prévoit la répartition des territoires issus de l’Empire Ottoman alors en pleine décomposition. Dans les années suivantes, les différents traités actent le redécoupage régional : le Royaume-Uni obtient un mandat sur l’Irak (et la Palestine et la Transjordanie) ; de son côté, la France obtient un mandat sur la Syrie et ce qui deviendra le Liban. Les deux pays auront ensuite des trajectoires différentes : l’Irak obtient son indépendance de la tutelle britannique en 1932, alors que la Syrie devra patienter jusqu’en 1946. La FIFA déjà très ancienne – créée en 1904 – cherche à attirer de nouveaux membres. Dans un contexte d’entre-deux-guerres, l’institution veut rallier à sa cause les fédérations syriennes et libanaises. La fédération de football syrienne voit le jour en 1936, s’affilie à la FIFA en 1937 (un an après celle du Liban). Quant à l’Irak, la fédération de football est créée en 1948 pour être reconnue en 1950 par la FIFA.
Sur le plan du football, l’Irak et la Syrie n’ont pas de relation particulière comme l’explique le journaliste Hassanin Mubarak : « les matchs entre la Syrie et l’Irak n’ont pas une grande signification historique ou politique, ils n’ont jamais été de grands rivaux en ce qui concerne le football ». Les deux équipes s’affrontent pour la première fois en 1955, en Iran, lors d’un match opposant deux équipes composées majoritairement de de militaires. Il faut attendre 1966 pour voir la première confrontation en match officiel, lors de la finale de la 3e édition de la Coupe arabe des nations. L’Irak remporte alors le titre, les deux pays se retrouvent ensuite au même stade en 1988, l’Irak s’imposant de nouveau au terme d’une séance de tirs au but.
Durant les années 60-70, la géopolitique entre en jeu. Les deux pays s’allient dans le boycott d’Israël. La fédération israélienne de football est affiliée à la FIFA dès 1929 et est inclue dans la Confédération asiatique, reconnue par la FIFA en 1954 avec divers pays membres. Immédiatement, le pays participe aux deux premières éditions de la Coupe d’Asie des Nations crée en 1956, et ira en finale des deux premières éditions. La compétition est organisée en Israël en 1964 avec une victoire au bout du pays hôte. Mais ces éditions ont un caractère spécial : aucun pays arabe n’y participe, y compris l’Iran. En 1968, l’Iran est sacré et bat même Israël en tant que pays hôte. Ce mouvement de « boycott » fait naturellement suite à la création de l’Etat d’Israël en 1948, aux différentes guerres l’ayant opposé aux pays arabes, comme la Guerre des Six Jours (1967) ou la Guerre du Kippour (1973). Le boycott est si massif que le pays gagne parfois plusieurs matchs de suite sur tapis vert. Israël est finalement exclu de l’AFC en 1974.
Football, état et sécurité
Le Moyen Orient, dans une vision large, étant une véritable poudrière qui regorge de conflits (Afghanistan, Syrie, Irak, Yémen etc…), il faut trouver des lieux pour accueillir ces équipes. En Syrie et en Irak, les guerres ravagent des pans entiers du pays. Depuis 2011, une guerre civile fait rage, où le régime de Bachar al Assad et les rebelles s’affrontent, sans oublier les « organisations terroristes ». Les puissances étrangères ont une grande influence sur le conflit et cela se ressent jusque dans le football. En effet, l’Iran, soutien indéfectible du régime de Damas, veut s’imposer comme puissance régionale, face à un bloc, sunnite, opposé au régime, avec des pays comme l’Arabie Saoudite ou le Qatar. En Irak, il y a aussi ce jeu de puissance. L’Iran est le « parrain » des innombrables milices chiites présentes (comme en Syrie, d’ailleurs) et les liens avec le régime de Bagdad ne sont plus à prouver. Il y a aussi une autre entité qui affecte le football, il s’agit du Kurdistan irakien. Cette région autonome avec son propre gouvernement défit régulièrement celui central à Bagdad. D’ailleurs, le Kurdistan a créé sa fédération de football ainsi que son équipe, toutes deux non reconnues. Un match dans cette région n’est pas exclu à l’avenir, la zone est jugée « sécurisée » et fait légalement partie de l’Irak.
Aujourd’hui, la situation sécuritaire en Syrie et en Irak rend impossible la tenue de rencontres de football. La priorité n’est plus au développement du football. En Syrie, vous pouvez encore jouer au football si vous êtes dans les zones « sécurisées » de Damas, alors que cela est inconcevable par exemple à Alep. Pourtant, les fédérations des deux pays existent encore. Selon la FIFA, « peut devenir membre de la FIFA toute association responsable de l’organisation et du contrôle du football et de toutes ses variantes dans son pays. ». Pour la FIFA, il y a des exceptions à la stricte règle énoncée : comme « les entraves des Israéliens au développement du football en Palestine, ou sur les pratiques du Qatar ». Pour M. Hassanin, « la suspension d’une nation se fait généralement par un consensus international, comme pour l’Afrique du Sud pendant l’Apartheid, l’Irak après l’invasion du Koweït ou l’ex Yougoslavie ». Avant de rajouter : « les Etats Unis ont envahi l’Irak et l’Afghanistan, si les pays voulaient vraiment un consensus, Israël serait suspendu. La FIFA ne crée pas les décisions, ce sont les nations ». James Dorsey, chercheur dans le domaine de l’influence du football Moyen Orient, va dans ce sens : « si les règles de la FIFA étaient appliquées à la règle, beaucoup de pays du Moyen Orient seraient bannis ou sanctionnés ».
Le sport fait partie de l’appareil d’Etat. La politique fait partie intégrante de l’organisation du football dans le pays : les personnalités en charge sont nommées par le pouvoir politique. Plus globalement, au Moyen-Orient, le football est souvent financé par l’Etat ce qui, compte tenu du contexte, rend difficile tout développement. Difficile donc pour l’instance mondiale de passer complètement outre et d’y imposer ses règles. Il est clair que certains clubs, totalement sous le contrôle des militaires en Syrie ou en Irak ont la possibilité de continuer à exister. Il y a une politique claire de la FIFA : « La FIFA va dire que ce sont les affaires irakiennes ou syriennes, la FIFA ne veut pas faire d’ingérence » selon M. Dorsey, avant de poursuivre et de donner le cas d’Al Jaish. « Le club est basé à Damas, c’est un club de football mais ce sont des militaires qui le gèrent, dans une zone close ». La fédération syrienne de football est officiellement située à Damas, elle y est effective, confirme Yves Gonzalez-Quijano, chercheur. Mais c’est sans compter sur l’immense aide qu’a porté (et porte encore) Oman, dans l’accueil des joueurs et parfois des matchs. Selon James M. Dorsey : « un certain nombre des activités de la fédération se déroulent à Oman. Le pays leur a apporté ou leur apporte encore un grand soutien pour le football ». Selon le chercheur, Oman se voit toujours comme un médiateur crédible loin de l’attention – à l’inverse du Qatar – sans qu’il n’y ait pourtant rien de concret sur le football, s’agissant d’une coopération plus globale.
Les relations entre la fédération irakienne et la FIFA ne sont pas mauvaises, même s’il y a eu des problèmes concernant l’interdiction d’organiser des matchs en Irak. Les Irakiens souhaitent organiser une rencontre sur leur sol, que ce soit à Erbil, Karbala ou Bassora et espère que l’instance international lui donnera le feu vert. En effet, une entrevue entre les autorités et la FIFA pour inspecter les lieux ne cessait d’être reportée. Cette dernière a finalement eu lieu et les commentaires sont unanimes : les installations sont excellentes, principalement à Bassora, selon un communiqué gouvernemental. Les autorités espèrent maintenant pouvoir organiser une rencontre et même la construction d’un nouveau stade à Najaf. Dans les faits, l’Irak n’a plus joué « à domicile » une rencontre au Qatar ou en Arabie Saoudite depuis 2015. A l’inverse, en 2016, sur 6 rencontres où l’Irak « recevait », 4 ont été disputées à Téhéran, en Iran. La situation de l’équipe nationale syrienne est encore différente, peu de matchs joués et aucun match en Syrie depuis 2010. Depuis 2013, des matchs exclusivement en Iran, en Malaisie ou au Sultanat d’Oman. Le premier match après le déclenchement de la révolution syrienne, entre la Syrie et le Tadjikistan a eu lieu à Amman, en Jordanie.

Terres d’accueil
Le contexte géopolitique régional est un des facteurs importants. Les relations diplomatiques évoluent au fil des années et des conflits. Cela est logique, « l’Iran n’aurait jamais accueilli des matchs de l’Irak dans les années 80 (pendant la guerre entre les deux pays, notamment) » explique M. Hussanin. Aujourd’hui, les dirigeants chiites dominent la scène politique, avec le soutien de Téhéran, autant diplomatiquement que militairement, il y a donc une certaine normalité dans ces choix pour Paul Dietschy. M. Gonzalez-Quijano va dans ce sens et estime qu’il faut prendre de la distance et voir le problème très largement, au niveau des relations globales entre les deux pays. Au même titre que « la Syrie a tenté d’aider l’Irak quand elle y avait des sanctions de la FIFA, mais aussi pour garder de bonnes relations entre fédérations interarabes et nationales ».
Le choix du lieu de la rencontre appartient à la nation « hôte », mais nécessite une approbation de la FIFA. Notons que pour la campagne de qualifications à la Coupe du Monde 2014 et Coupe d’Asie 2015, l’Irak a joué aux Emirats Arabes Unis et en Jordanie où elle y a rencontré un problème majeur : la rentabilité. Certaines rencontres se jouaient dans des stades quasi-vides, sans supporters et sans revenus. Depuis ces matchs, l’Irak ne joue toutes ses rencontres à Téhéran et en Malaisie (Seremban, Shah Alam). « La fédération voulait trouver un lieu facilement accessible pour remplir un minimum les stades – ce qui ne fut pas le cas à Doha par exemple » commente M. Mubarak. Au-delà de l’aspect sécuritaire, il faut donc prendre en compte de côté pratique. En effet, la Syrie n’a aucune relation diplomatique avec les pays du Golfe (Arabie Saoudite, Qatar, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït) et doit ainsi trouver d’autres pays pour les accueillir. La question parait peut-être frivole : qui souhaite accueillir la Syrie ? Au même titre qu’une autre : quelle fédération serait d’accord pour jouer à Bagdad ?
Si l’on y regarde de plus près, la Syrie joue tous ses matchs à « domicile » à Oman, en Malaisie et surtout en Iran. Il est intéressant de noter que ces trois pays ne requièrent pas l’obtention d’un visa pour l’entrée sur leur territoire d’un citoyen syrien (souvent sous réserve d’un séjour n’excédant pas 30 jours). Pour d’autres pays, comme il a été dit, soit les relations diplomatiques sont inexistantes soit la demande d’un visa a peu de chance d’aboutir. Hassanin Mubarak estime qu’il est par exemple impensable que le Japon, l’Australie ou la Corée du Sud acceptent d’accueillir un match de la Syrie. Quant à l’Irak, la localisation des rencontres est sensiblement identique : Malaisie et Iran uniquement depuis 2015. Un visa iranien pour un ressortissant irakien est peu onéreux.
Non seulement cela rend plus facile l’organisation des rencontres pour faire venir les joueurs et le staff, mais il y a aussi les supporters. L’aspect pratique et financier n’est donc pas à occulter dans la prise en compte des différents facteurs. Pour les supporters irakiens, la proximité de l’Iran n’est pas négligeable, pour se déplacer et pour les coûts. Toutefois, peu de personnes ont les moyens de se déplacer pour suivre les matchs de leur équipe, hors du pays dans lequel ils vivent. Mais certains irakiens ou syriens vivent en Iran. Enfin, il y a aussi un intérêt sportif à choisir par exemple la Malaisie. Prenez le groupe de la Syrie, avec Iran, Corée du Sud, Ouzbékistan, Qatar et Chine. Le choix de la Malaisie est d’un sens logique, il n’avantage ni l’Iran ni le Qatar (si tant est qu’une rencontre plus ou moins proche du Golfe est possible).

Le football continue
Ainsi, l’Irak et la Syrie s’affrontent régulièrement, car très tristement, ce sont les matchs les plus simples à mettre en place, « la seule raison qui fait que la Syrie et l’Irak s’affrontent si souvent, c’est qu’aucune des fédérations n’arrivent à convaincre d’autres adversaires de jouer contre eux » estime H. Mubarak. Par exemple, depuis le début de la guerre civile en Syrie, les deux pays se sont affrontés à 5 reprises. En mars 2013, le match a eu lieu à Bagdad, une première depuis 2009. La même année, la FIFA a levé l’interdiction pour l’Irak d’organiser des matchs amicaux sur son sol (rétabli aujourd’hui). La dernière confrontation s’est tenue à Téhéran en mars 2016 (et la Syrie l’a emporté 1-0). Malgré les combats, la vie continue. L’équipe irakienne comme la syrienne ont atteint le 3e tour des qualifications de la zone Asie pour la Coupe du monde 2018. Certes, les deux équipes ont peu de chance de se qualifier pour la phase finale, et ne devraient pas non plus atteindre la phase des barrages, mais cela démontre un formidable espoir au milieu de la guerre.
Les joueurs de l’équipe nationale syrienne peuvent s’analyser en deux groupes : ceux qui sont « pro-régime » et ceux qui ont considéré partir. C’est dans cette dernière catégorie qu’une nouvelle distinction est faisable : il y a d’abord ceux qui ont voulu partir mais qui n’ont pas pu pour des raisons diverses (d’ordre familiales notamment) et ceux qui ont préféré rester découvrant la situation des réfugiés qui tentent de fuir le chaos. Pour M. Gonzalez-Quijano, il y a surtout une « grande fierté de jouer pour son équipe nationale ». En ce qui concerne le football local, comme les championnats, ils continuent tant bien que mal. En Syrie dans les zones contrôlées par le régime et en Irak il demeure. Comme depuis toujours, et notamment sous le régime de Saddam Hussein, c’est le régime qui dirige le football. En Syrie aussi, militaires et forces de sécurité tiennent le football. C’est un moyen d’expression politique comme un autre.
L’intérêt que portent les populations moyen-orientales au football est immense, malgré les guerres et les morts, le football a toujours une part dans la vie de ceux qui ont la chance de pouvoir y participer. Les performances des équipes nationales syriennes et irakiennes sont remarquables dans ce contexte. Dans les stades aussi, le football est un vecteur politique. On y chante à la gloire de son pays, on montre sa supériorité ou on lutte contre d’autres. « Comme ce fût le cas notamment en Egypte sous Nasser ou Moubarak » explique Paul Dietschy. Les stades ont souvent été le vecteur de domination pour le régime : d’Hafez al Assad à Saddam Hussein. Et de conclure : « le football est un moyen d’affirmation régionale et mondiale (comme pour les Etats du Golfe) et pour toutes sortes de lutte ». En définitive, un but marqué n’a pas seulement une dimension sportive, le but est aussi politique, comme un but de résistance.
James M. Dorsey est chercheur à la Singapore S. Rajaratnam School of International Studies et co-directeur de l’Institute of Fan Culture de Wuerzburg. Il a notamment écrit sur le sujet : The Turbulent world of Middle East soccer.
Hassanin Mubarak est un journaliste irakien, il tient le blog : Iraqi football.
Yves Gonzalez-Quijano est chercheur au GREMMO et tient notamment un blog : Culture et politiques arabes.
Paul Dietschy est professeur, historien spécialiste de l’histoire du football. Il a écrit différents ouvrages dont : Histoire du football ou l’article : « Le Sport, instrument des relations internationales ».